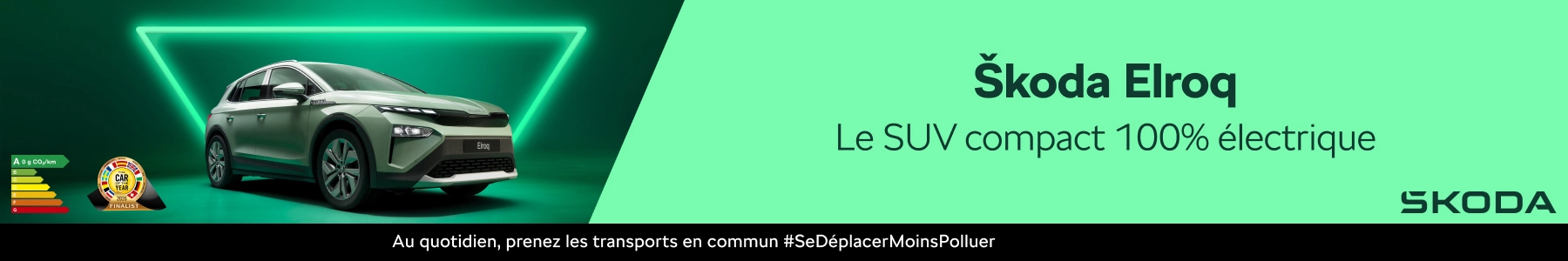01/09/2017 - #Opel
Avec l’entrée en vigueur du WLTP arrive aussi le NEDC transposé…
A partir de ce 1er septembre 2017, le cycle WLTP remplace le cycle NEDC pour la mesure des émissions de CO2, dans un premier temps uniquement pour des véhicules d’un nouveau type avant de s’étendre en septembre 2018 à l’ensemble du marché. Dans les faits, les valeurs NEDC devraient faire encore référence jusqu’en janvier 2019.
| Abonnements | Info | Marché | Club |
|---|---|---|---|
|
Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités |
|||
|
Recevoir par mail les Alertes Infos |
|||
|
Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements |
|||
|
Accès illimité à tous les articles du journal |
|||
|
Accès illimité à la base de données statistiques automobile |
|||
|
Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com |